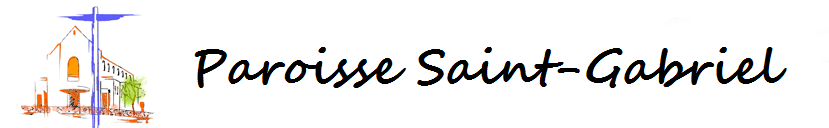un livre de William March.
Cet ouvrage de William March (1893-1954), de son vrai nom William Campbell, compte sans nul doute parmi les documents les plus forts et les plus saisissants écrits sur la Grande Guerre. L’auteur lui-même combattit en France dans les rangs de l’US Marine Corps et revint chez lui, aux USA, couverts de multiples décorations et distinctions pour ses faits d’arme. Plus tard, hanté par ses souvenirs de guerre, il écrivit, au long de nombreuses années, ce livre, « Compagnie K », qui n’est rien de moins qu’un chef d’oeuvre.
Une des grandes originalités de l’ouvrage tient à sa construction. Au lieu de raconter ses propres souvenirs, William March, au fil de chapitres très courts, donne la parole, tour à tour, à chacun des membres d’une compagnie. 115 hommes prennent ainsi la parole, relatant chacun un épisode, une scène, un événement dont il fut l’acteur ou le témoin. L’ensemble fait penser à une mosaïque dont chaque élément reflète et révèle un des aspects de la guerre, un des comportements possibles de l’homme en guerre.
Ce sont des soldats américains qui parlent parce que ce sont ceux que l’auteur connaît mais, comme il l’affirme lui-même dès le début du livre, les hommes ici évoqués « pourraient tout aussi bien être français, allemands, anglais, ou russes. » Les comportements ne diffèrent pas d’une nation à l’autre. Partout l’on trouvera des hommes courageux capables de faits glorieux, mais partout aussi l’on trouvera la peur, la lâcheté, la révolte, le désespoir, les rêves, les gestes de compassion, voire les moments de drôlerie.
Il y a de tout cela dans « Compagnie K », chaque chapitre mettant en scène l’un de ces aspects. Parfois même deux chapitres successifs se répondent l’un l’autre. Impossible de tout énumérer. Bien sûr, des soldats évoquent des femmes rencontrées, désirées, parfois abandonnées. L’un raconte comment il convainquit « une femme bien » de passer une nuit avec lui, l’autre la fascination qu’il éprouve pour le visage de Lillian Gish (une actrice du cinéma muet de l’époque), un autre encore comment il fut déserteur malgré lui à cause d’une fille. Un autre, que la faim tenaille, rêve plus prosaïquement d’un bon repas. Mais il se trouve aussi des soldats poètes : l’un qui, blessé et hospitalisé, pleure en récitant du Verlaine (« Il pleure dans mon cœur…), l’autre qui se sent bien isolé parmi ses camarades qui n’ont que faire de sa poésie (mais ignorant que l’un d’eux n’y est pas insensible) !
Beaucoup de chapitres soulignent l’absurdité de la guerre. Quand les soldats américains sont confrontés directement aux soldats ennemis, il se déroule des scènes que les protagonistes n’oublieront jamais. Ils en seront hantés jusqu’à la fin de leurs jours. Ainsi de ce soldat américain qui tue un soldat allemand, croyant que celui-ci tient une grenade dans ses mains, et qui découvre ensuite qu’en fait de grenade l’ennemi serrait dans ses mains la photo de sa fille. Ou de cet autre qui, pris de pitié en entendant les lamentations d’un prisonnier allemand gazé, lui donne son masque à gaz, tout en se demandant pourquoi il a fait ça. Mais le plus terrible, c’est quand l’ordre est donné de fusiller des prisonniers : l’un a le cran de refuser, un autre accepte mais, traumatisé, se dit que c’est un mensonge que d’affirmer que Dieu est amour.
Plus d’un intervenant parle d’ailleurs de la foi chrétienne mais c’est le plus souvent avec des mots de révolte. S’il est un soldat qui affirme avoir vu le Christ pleurer et avoir pleuré avec lui, il en est d’autres qui rejettent les paroles, voire la présence même de l’aumônier. L’un d’eux, entendant l’aumônier demander à Dieu la mort des ennemis impies, se dit avec justesse que, des deux côtés, du côté américain comme du côté allemand, on prie le même Dieu.
Même si quelques-uns rapportent des scènes humoristiques (une séance d’épouillage qui tourne en spectacle pour les civils qui en sont les témoins éberlués ; ou encore un soldat blessé qui, étant visité par la reine d’Angleterre en personne, la confond avec une voisine de sa mère!), dans la plupart des cas c’est la souffrance, l’incompréhension et la révolte qui dominent. Cela va, chez certains, jusqu’à un refus des honneurs qui pourraient leur être rendus : ainsi de ce soldat qui, pris mortellement dans des barbelés, trouve la force de jeter loin de lui toute marque d’identification afin de n’être plus qu’un anonyme. Plusieurs évoquent le retour au pays, mais c’est avec bien des désillusions : l’un d’eux retrouve sa fiancée qui ne veut plus de lui à cause de sa gueule cassée, un autre se désole au sujet de son frère qui n’a passé que trois jours au combat et à qui l’on rend plus d’honneurs qu’à lui qui y a passé des mois.
Peut-être est-ce le soldat Andrew Lurton qui trouve le mieux les mots pour dire sa désillusion : « J’aimerais, dit-il, que les types qui parlent de la noblesse et de la camaraderie de la guerre puissent assister à quelques conseils de guerre. Ils changeraient vite d’avis, parce que la guerre est aussi infecte que la soupe de l’hospice et aussi mesquine que les ragots d’une vieille fille. »
Chaque chapitre de ce grand livre est comme un petit chef d’oeuvre à lui tout seul. Pas besoin de s’épancher longuement, tout est dit avec netteté et sécheresse et l’on sent bien que ce que rapporte William March est vrai, foncièrement vrai, même si l’auteur n’a pas été le témoin de tout ce qu’il raconte. La guerre est ainsi, se dit-on, elle n’est pas belle à voir, et les hommes qui s’y livrent nous chamboulent le cœur !
William March, « Compagnie K », éditions Gallmeister, 259 pages.
Luc Schweitzer, sscc.