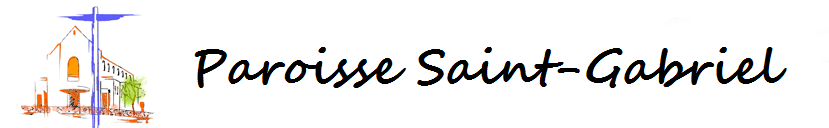Un film de Ryûsuke Hamaguchi.
Quand on a affaire à un film d’une durée de trois heures, il est important que, dès le début, dès les premières scènes, l’on soit intrigué, voire captivé, et c’est bien le cas avec Drive my car, une œuvre si belle, si riche, si profonde qu’il n’y a pas de risque de se lasser en cours de projection. D’entrée de jeu, c’est la parole qui est mise en évidence. Une femme raconte une histoire à un homme après avoir fait l’amour avec lui. C’est dans le plaisir sexuel qu’elle trouve l’inspiration nécessaire à son travail de scénariste. Elle se prénomme Oto (Reika Kirishima) et, comme on l’apprend lors d’une scène plus tardive, c’est parce qu’elle ne peut plus se consacrer à la danse qu’elle s’est reconvertie dans l’écriture de scénarios. L’homme qui est avec elle, c’est Yûsuke Kafuku, son mari, un metteur en scène qui a le projet de monter Oncle Vania de Tchekhov tout en en jouant le rôle-titre. En les voyant, on a le sentiment qu’ils sont très épris l’un de l’autre. On est d’autant plus surpris, lors d’une des scènes suivantes, de découvrir Oto faisant l’amour avec un autre homme. Yûsuke lui-même surprend leurs ébats, mais sans manifester sa présence, sans divulguer à sa femme qu’il sait qu’elle le trompe. Plus tard encore, alors que Yûsuke s’était attardé hors du domicile conjugal, rentrant chez lui, il découvre Oto morte à la suite d’un accident cérébral.
Ce que je viens de résumer sert de prologue au film dont l’action se poursuit deux ans après ces faits. On voit sur le visage de Yûsuke qu’il reste profondément marqué par son histoire avec Oto, d’autant plus que, comme on l’apprend, le couple avait eu un enfant, une fille, décédée d’une maladie à l’âge de quatre ans. Or, voici que le metteur en scène est invité à un festival de théâtre à Hiroshima où il lui est proposé de monter à nouveau Oncle Vania. Pas question, pour lui, à priori, de jouer, cette fois-ci, le rôle principal. Mais il lui est laissé le libre choix de sa distribution parmi un éventail de comédiennes et comédiens multilingue. Ce sera la particularité de cette version de la pièce que de la jouer en plusieurs langues, les comédiennes et comédiens étant japonais, mais aussi taïwanais et coréens. Plus étonnant encore, il se trouve, parmi les candidats, une jeune coréenne, Lee Yoon-a (Yoo-rim Park), qui, étant sourde et muette, ne peut s’exprimer que par la langue des signes. Ce qui n’embarrasse nullement Yûsuke qui lui confie le rôle de Sonia dans la pièce de Tchekhov. On apprend d’ailleurs, plus tard, que cette jeune femme est également l’épouse d’un des deux organisateurs du festival.
La parole, si importante dans ce film, c’est donc également celle de Tchekhov, car de nombreuses scènes se déroulent au cours des répétitions de la pièce. Un auteur, un dramaturge, on ne peut mieux choisi, tant ses pièces, entre autres Oncle Vania, s’accordent merveilleusement avec les personnages eux-mêmes du film, leurs blessures, leur mélancolie. À tous les comédiens, au metteur en scène, aux organisateurs du festival, s’ajoute une jeune femme qui, elle, ne fait pas de théâtre, mais est engagée pour servir de chauffeur à Yûsuke. Ce dernier n’a pas le choix, c’est le règlement même du festival qui le lui impose. La jeune femme se nomme Misaki Watari (Tôko Miura) et elle a tôt fait de démontrer à Yûsuke qu’il n’aura pas à se plaindre d’elle. En effet, elle s’avère très bonne conductrice, elle est obéissante, ne dit rien, le metteur en scène profitant des trajets en voiture pour écouter les répliques de la pièce que sa défunte femme avait enregistrées sur une cassette. Mais les rapports entre ces deux personnages vont évoluer, les regards vont changer, la parole va se libérer. Et c’est lorsque Yûsuke se trouve au pied du mur, contraint de choisir s’il veut ou non jouer à nouveau le rôle d’Oncle Vania, le comédien qui devait s’en charger ayant fait défaut, c’est alors, au cours d’une virée jusqu’au village où a grandi Misaki, que les langues se délient. L’habitacle de la voiture, c’est aussi un lieu propice aux confidences. Et si Yûsuke est un homme meurtri et rongé de culpabilité, car il estime que c’est à cause de sa négligence que sa femme est morte, Misaki, elle aussi, a des reproches à se faire au regard de sa mère, une mère qui l’a élevée durement, une mère qui est décédée lors d’un glissement de terrain qui a englouti sa maison.
Le film se déploie, en somme, comme un processus de thérapie, de libération par la parole et par les gestes : les corps qui s’effleurent, se touchent, s’étreignent, que ce soit devant la maison enfouie de la mère de Misaki ou sur scène, lorsque la représentation a lieu. C’est alors que résonnent les mots de Tchekhov, ceux de la réplique finale de la pièce, que Lee Yoon-a (qui joue Sonia) exprime par la langue des signes, ce qui n’empêche nullement ces phrases de nous bouleverser : « quand notre heure viendra, dit Sonia, nous partirons sans murmure, et nous dirons dans l’autre monde que nous avons souffert, que nous avons été malheureux, et Dieu aura pitié de nous. »
Adapté d’une nouvelle de l’écrivain japonais Haruki Murakami, ce film poignant, beau, traversé de grâce n’a pourtant reçu qu’un prix de consolation à Cannes (le prix du scénario), alors qu’il méritait, sans nul doute, la Palme d’Or, bien plus que le médiocre Titane.
10/10
Luc Schweitzer, ss.cc.