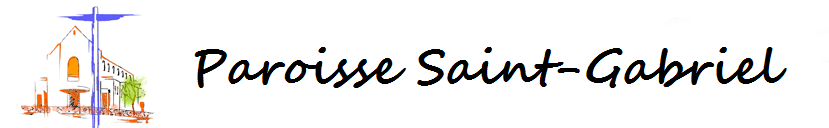Un film de Mohammad Rasoulof.
Il n’est nul besoin de se référer au diable pour expliquer le mal dont se rendent coupables les hommes. Ce serait trop commode que de toujours rejeter la faute sur l’autre. Dans certains cas, et singulièrement lorsqu’il s’agit d’infliger à quelqu’un la peine de mort, c’est dans la simple obéissance aux ordres reçus que peut se trouver la racine du mal. Autrement dit, à l’intérieur même de ce qu’on considère généralement comme bon (l’obéissance) apparaît, lorsque l’ordre reçu s’oppose à la conscience et au sens moral, un mal destructeur pour celui qui est tenu d’obéir. Qu’il se soumette ou qu’il se révolte, dans tous les cas, il n’en sort pas indemne. C’est ce qu’entreprend de raconter Mohammad Rasoulof, et je dis bien qu’il raconte, car il est préférable, sur ce sujet comme sur tant d’autres, d’opter pour des récits plutôt que pour des discours. C’est ce qu’avait fort bien compris Victor Hugo, en son temps, lorsqu’il publia (en 1829) Le Dernier Jour d’un Condamné.
Le cinéaste, lui, déploie son propos au moyen de quatre histoires. La première, la plus austère, la plus simple en apparence et, en fin de compte, la plus choquante des quatre, met en scène un homme du nom d’Heshmat dans son quotidien très ordinaire. C’est d’ailleurs l’impression qu’il donne, celle d’un homme comme les autres, si ce n’est qu’il apparaît comme particulièrement attentionné, soucieux de procurer aux siens de quoi se nourrir (il leur apporte un sac de riz), s’occupant, avec sa femme, des courses et du ménage, veillant au bien-être et de sa mère et de sa fille. Un homme modèle, en fin de compte. Mais un homme obéissant aux ordres donnés quand il est sur son lieu de travail. Un homme qui ne se pose pas de questions de conscience. On pense à Hannah Arendt, à ses propos sur « la banalité du mal ». La dernière scène de cette histoire est particulièrement glaçante.
La deuxième histoire que raconte le cinéaste, c’est celle d’un homme dont on peut dire qu’il est l’exact opposé de Heshmat. Il se nomme Pouya et nous le découvrons en tant que jeune appelé, dans sa chambrée où se trouvent plusieurs de ses camarades soldats. Agité, malade, pendu au téléphone où il s’efforce de négocier un passe-droit avec sa fiancée, il est mort de trouille à l’idée de devoir bientôt exécuter un condamné à mort, comme cela lui a été ordonné. Avec ses camarades de chambrée, les discussions et les arguments fusent, mais rien n’y fait, Pouya semble déterminé à tout faire pour ne pas devoir tuer un de ses semblables. Jusqu’où sera-t-il capable d’aller ?
La troisième histoire (tout comme la quatrième) se déroule dans un endroit reculé, loin de la ville, au milieu d’une splendide nature. C’est là qu’un soldat, ayant obtenu quelques jours de permission, vient retrouver sa bien-aimée en ayant l’intention de profiter de l’anniversaire de cette dernière pour la demander en mariage. Mais l’inattendu survient et fait vaciller le beau projet lorsque le jeune soldat découvre l’existence d’un rebelle que la famille de sa fiancée a caché jusqu’à ce qu’il soit rattrapé par la police, jugé et exécuté. On n’en dira pas plus sur le coup de théâtre que réserve le scénario, mais on peut, sans risque de trop en dévoiler, souligner la beauté du personnage de la jeune fille, promise au soldat permissionnaire, et faisant preuve d’une sacrée force d’âme. Enfin, dans la très touchante quatrième histoire, Rasoulof met en scène le séjour en Iran d’une jeune fille de 20 ans, étudiante en Allemagne, venue chez son oncle, un médecin interdit d’exercer son métier et s’étant retiré avec sa femme à la campagne. Ces vacances chamboulent la jeune fille, d’une part parce qu’elle apprend la raison pour laquelle son oncle est sanctionné, d’autre part parce qu’elle découvre des vérités insoupçonnées sur sa propre origine. On notera que c’est Baran Rasoulof, la fille du cinéaste, qui joue ici le rôle de la nièce venue d’Allemagne.
Je ne peux en dire plus sur chacune de ces intrigues, de peur de divulgâcher. Mais il convient de mettre en évidence l’habileté du réalisateur. Bien sûr, il signe un film en forme de réquisitoire contre la peine de mort, mais, en privilégiant la narration, il évite totalement le piège du didactisme. Son art de la mise en scène n’est jamais pris en défaut, son sens de la beauté éclate dans les troisième et quatrième histoires, totalement imprégnées de nature (entre autres parce que l’oncle, dans la quatrième histoire, est apiculteur). Il se fait fort aussi d’accorder aux femmes des rôles décisifs, ce qui ne va pas de soi quand on travaille dans un pays comme l’Iran. Mohammad Rasoulof, rappelons-le, a lui-même été persécuté par le régime de son pays, au point d’avoir fait de la prison. Son nouveau film prouve, si besoin est, qu’il n’a rien perdu, pour autant, de sa liberté de créateur. Le Diable n’existe pas a remporté, très opportunément, l’Ours d’Or à la Berlinale 2020.
8,5/10
Luc Schweitzer, ss.cc.