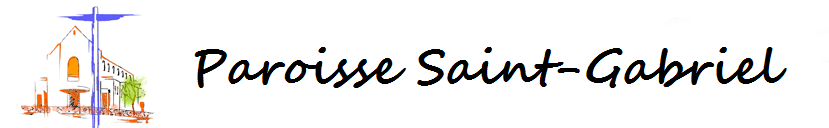Un roman de Philippe Forest.
En 2004, Philippe Forest avait écrit Sarinagara, qu’il appelait son « roman japonais », et il nous propose aujourd’hui, en quelque sorte, son prolongement, un « roman chinois » (étant entendu qu’il ne faut pas comprendre ici le mot « roman » sous son acception habituelle). Et puis, comme il avait donné pour titre, au premier, le mot (signifiant « cependant ») sur lequel s’achève un poème (un « haïku ») japonais, le nouveau livre, lui, est doté d’un titre chinois qu’on peut traduire par « théâtre d’ombres » (ce qu’on appelle, chez nous, « ombres chinoises », mais qui n’est qu’une piètre imitation de ce qui se fait du côté de Shanghai ou de Beijing.)
Quoi qu’il en soit, l’expression « théâtre d’ombres » s’applique à merveille à un livre qui, s’il y est question, en effet, de la Chine et des Chinois, aborde ce sujet avec l’approche modeste de qui est bien conscient de devoir se contenter d’ombres et de ne rien transmettre que de très parcellaire. Dès l’abord en effet, le récit s’imprègne fortement d’une dimension énigmatique en même temps que ludique, le narrateur ayant trouvé dans un « fortune cookie » (un biscuit), servi à la fin d’un repas dans un restaurant du « Chinatown » parisien (XIIIe arrondissement), un papier plié en quatre, sur lequel est écrit : « Au Secours ! Je suis prisonnière dans le quartier chinois ! »
Si le message trouvé dans le biscuit n’était évidemment pas à prendre à la lettre, il n’en eut pas moins son prolongement particulier dans l’itinéraire de Philippe Forest, l’écrivain étant, en effet, amené à se rendre, une ou deux fois par an, en Chine, ses livres y étant traduits et y rencontrant du succès. Et c’est ainsi que l’énigme reprit toute sa place, mais plus vague et plus impénétrable qu’avant : « J’avais l’impression, écrit Philippe Forest, que quelque chose m’attendait là-bas que je ne devais pas laisser passer la chance de découvrir. Quoi ? Je ne le savais pas. » Plus avant dans son récit, l’auteur, en citant un écrivain chinois du nom de Shi Tiensheng (1951-2010), perçoit qu’en fin de compte il n’y a d’autre solution à l’énigme que l’énigme elle-même. C’est la quête qui compte, plus que l’aboutissement qui n’a jamais lieu.
« Je la connais si peu, s’empresse de dire l’auteur à propos de la Chine, que je me garde bien de m’imaginer que je la comprends… » Cette conviction, il ne cesse de la répéter, tout au long du livre, comme un leitmotiv. Et les écrivains auxquels il se réfère, un chapitre après l’autre, sont précisément ceux qui furent pénétrés d’une opinion identique sur ce point précis : la Chine, on peut parler d’elle, on peut écrire sur elle, mais on ne peut avoir la prétention ni de la connaître ni de la comprendre. Des écrivains aussi différents l’un de l’autre que Roland Barthes et Simon Leys (qui fut certainement l’un des auteurs les plus clairvoyants au sujet de la Chine) se rencontrèrent sur ce point précis : ce pays, nul ne le connaît ni ne le comprend !
Néanmoins, cela étant dit, Philippe Forest n’en déroule pas moins son « roman chinois », soucieux de régulièrement stimuler l’intérêt du lecteur en multipliant les approches et les expériences. En plus des écrivains déjà nommés, il prend soin d’évoquer d’autres auteurs venus d’Occident et qui furent fascinés par la Chine : en particulier, Pearl Buck et Paul Claudel. Mais il accorde aussi, fort heureusement, une large part de son récit aux écrivains chinois, non seulement Shi Tiensheng, mais aussi Lu Xun (1881-1936) (dont l’œuvre « témoigne d’un assez profond pessimisme qui confine parfois au nihilisme le plus pur », écrit-il), Bi Feiyu (né en 1964), Wang Anyi (née en 1954), Zhou Zuoren (1885-1967) ou Fang Fang (née en 1955) qui fit la chronique du confinement dû à la COVID dans Wuhan, ville close, ouvrage qui lui valut des ennuis pour avoir été perçu, en Occident, comme un pamphlet dirigé contre le régime chinois (ce qui était une interprétation abusive).
En fin de compte, pour qui lit attentivement l’ouvrage de Philippe Forest, il saute aux yeux, en quelque sorte, que l’auteur ne cesse de tourner autour d’un seul sujet : la mort. C’est elle, l’énigme sans solution autre qu’elle-même, d’autant plus qu’elle apparaît à l’auteur, obsessionnellement (et comment pourrait-il en être autrement), sous l’aspect de sa propre fille Pauline, décédée d’un cancer alors qu’elle était une toute petite fille. Philippe Forest le dit, il n’y a pas d’autre sujet pour lui et il l’aborde, d’une manière ou d’une autre, dans chacun de ses ouvrages. Dans Pi Ying Xi, dès le début, il raconte la « fête des morts » à Shanghai (fête qui a lieu, en Chine, en avril) avec son rite particulier qui consiste à brûler des papiers sur lesquels figurent les dons que l’on destine aux morts. Et ainsi de suite car c’est bien la mort, et singulièrement celle de sa fille, qui s’invite, que ce soit en filigrane ou de façon plus évidente, tout au long des pages du livre de Philippe Forest. Que ce soit en Chine ou à Paris, dans le XIIIe arrondissement, à l’occasion d’une errance dans des galeries commerciales chinoises aux boutiques enchevêtrées, errance qui lui rappelle un épisode vécu à l’époque où sa fille vivait encore et devait subir une opération.
Ajoutons, pour finir, qu’aux yeux de Philippe Forest, qui se déclare volontiers non-croyant, la quête de l’énigme qui n’a d’autre solution qu’elle-même n’est pas totalement absurde. Ou, en tout cas, elle semble être gouvernée par une sorte de logique que l’auteur ne comprend pas mais dont il fait état : « un dieu, écrit-il, – auquel, pourtant, on ne croit pas – , une providence – dont ont fait « comme si » elle existait tout en sachant bien que ce n’est pas le cas – veillant sur vous et puis guidant vos pas. »
9/10
Luc Schweitzer, ss.cc.
Autres citations :
- « On lit souvent, et je veux bien le croire, que les Chinois sont les moins religieux des hommes. La foi leur fait défaut. Les rites et les superstitions leur suffisent. Les premiers chrétiens qui, avec peu de succès, ont tenté d’évangéliser le pays ont été horrifiés par l’athéisme tranquille des hommes et des femmes auxquels ils prêchaient la bonne parole. »
- « Je ne suis pas croyant. La religion m’indigne, même quand elle s’en vient sanctifier l’insupportable sort que Dieu réserve souvent aux vivants. Et pas seulement quand il s’agit d’enfants. Mais, à ce compte-là, ma préférence va quand même au catholicisme qui a choisi pour emblème la figure du Fils de l’Homme supplicié sous les yeux de son Père tandis que sa Mère veille au pied du calvaire. Ne taisant rien de la désespérance dont témoigne le cri déchiré que pousse la victime sur la croix – semblant douter du salut auquel, sans aucune certitude, la foi seule, pour ceux qui l’ont, permet de croire. »